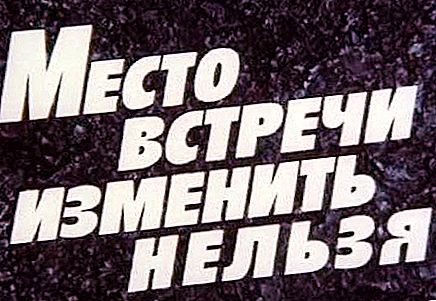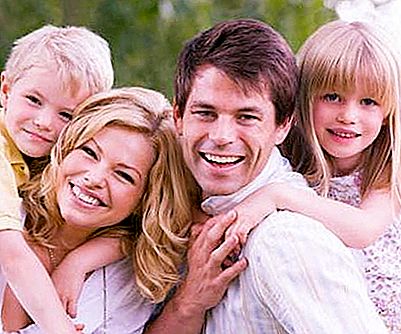La plupart d'entre nous savent ce qu'est la philosophie et la théologie. Cependant, très peu de gens connaissent l'interprétation du terme "théodicée". Ceci, quant à lui, est une doctrine philosophique très importante, sur certaines idées auxquelles, sans le savoir, chacun a pensé au moins une fois dans sa vie. Voyons ce qu'il étudie et sur quels principes il se fonde.
L'origine du mot
Ce terme vient du grec ancien. Il est formé des mots theos ("Dieu") et dike ("justice").
Quand et par qui il a été utilisé pour la première fois n'a pas été révélé. Cependant, bien avant que la théodicée ne soit utilisée comme terme spécial, le mot est apparu dans des œuvres distinctes de nombreux penseurs et philosophes.
Qu'est-ce que la théodicée?
Après avoir considéré ce que signifie le nom étudié, il sera plus facile de comprendre sa signification. En effet, c'est en ce nom que réside l'essence de la théodicée, c'est-à-dire un ensemble de doctrines religieuses et philosophiques visant à justifier la présence du mal dans le monde, à condition que l'univers soit contrôlé par le Tout-Puissant tout-puissant et bon.
Principes de base
Assez souvent, la théodicée est appelée «justification de Dieu», bien que tout au long de son existence certains philosophes et théologiens se soient disputés sur l'opportunité d'essayer de juger les actions du Créateur de l'univers.
Celui qui a osé parler des causes de la souffrance des gens a toujours dû construire ses arguments en tenant compte de 4 principes:
- Dieu existe.
- Il est tout bon (gentil).
- Tout-puissant.
- Le mal existe vraiment.
Il s'est avéré qu'en soi chaque principe de la théodicée n'était pas contraire à un autre.
Cependant, si nous les considérons tous en même temps, des contradictions ont surgi, qu'ils essaient toujours d'expliquer.
Qui est le "père" de la théodicée
Ce terme a été introduit avec la main légère du célèbre philosophe, logicien et mathématicien allemand Gottfried Wilhelm Leibniz.

Cet homme était vraiment un génie universel. C'est lui qui a développé les fondements du système binaire de calcul, sans lequel l'informatique ne pourrait exister.
De plus, Leibniz est devenu le père de la science de la combinatoire et, parallèlement à Newton, a développé le calcul différentiel et intégral.
Parmi les autres réalisations de Gottfried Leibniz figure la découverte de la loi de conservation de l'énergie et l'invention de la première machine à calculer mécanique, qui a non seulement pu additionner et soustraire, mais aussi multiplier et diviser.
En plus d'un intérêt actif pour les sciences exactes, Gottfried Wilhelm Leibniz a également étudié la philosophie et la théologie. En tant que scientifique, il est resté un croyant sincère. De plus, il était d'avis que la science et la religion chrétienne ne sont pas des ennemis, mais des alliés.
Comme toute personne rationnelle avec une pensée logique bien développée, Leibniz ne pouvait s'empêcher de remarquer quelques contradictions dans les dogmes chrétiens sur la bonté du Très-Haut et du mal mondial.
Afin de régler en quelque sorte ce «conflit» tacite, le scientifique publia en 1710 un traité «L'expérience théodicée sur la bonté de Dieu, la liberté humaine et l'origine du mal».
Ce travail est devenu très populaire et a encouragé la formation finale de la doctrine de la théodicée.
C'est devenu un sujet de controverse très populaire, non seulement en philosophie, mais aussi en littérature.
Théodicée dans l'antiquité
Les tentatives pour expliquer pourquoi le Créateur permet la souffrance et l'injustice ont été dans les temps anciens. Cependant, à l'ère du polythéisme (polythéisme), cette question a été considérée dans une veine légèrement différente. Puisque chacune des divinités avait sa propre sphère d'influence, on pouvait toujours trouver quelqu'un à blâmer pour les problèmes de l'humanité.
Mais même à cette époque, les penseurs pensaient déjà à la racine du mal en principe et à l'attitude complice des pouvoirs supérieurs à son égard.
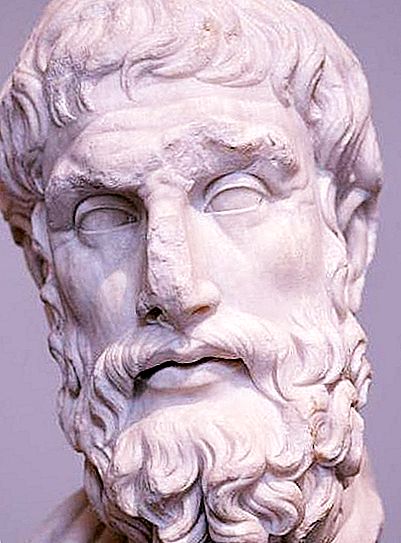
Ainsi, l'une des premières discussions sur ce sujet appartient à Epicure Samosky. Il a exprimé 4 explications logiques sur la façon dont une bonne puissance supérieure est capable de permettre le mal.
- Dieu veut débarrasser le monde de la souffrance, mais ce n'est pas en sa puissance.
- Dieu peut sauver le monde du mal, mais il ne le veut pas.
- Dieu ne peut pas et ne veut pas débarrasser le monde de la souffrance.
- Dieu peut et veut sauver le monde de la souffrance, mais non.
En plus d'Epicure, d'autres penseurs anciens y ont pensé. Il y avait donc déjà à cette époque une manifestation très tangible de la théodicée en philosophie. Ceci est typique des écrits de Lucian (le dialogue "Zeus condamné") et Platon (a soutenu que l'existence du mal n'est pas un argument fiable contre l'existence du Tout-Puissant et son bon caractère).
Ils ont ensuite été utilisés par les théologiens chrétiens pour former leur propre doctrine.

Le fait qu'Épicure, Lucien, Platon et d'autres philosophes anciens aient réfléchi au paradoxe de l'existence de la souffrance et de la bonté divine à l'époque du polythéisme suggère que le problème de la théodicée est plus ancien que de nombreuses religions modernes.
Théodicée médiévale
Après que le christianisme ait finalement pris forme en tant que religion et ait même acquis une forme militante, pendant plusieurs siècles, les philosophes et les théologiens n'ont même pas pu se permettre d'exprimer leurs pensées sur l'imperfection du monde. Après tout, l'Inquisition était sur ses gardes, prête à prendre la vie de quiconque n'ose que réfléchir sur les défauts du christianisme. Et il y en avait beaucoup, et les autorités laïques et religieuses n'hésitaient pas à opprimer les gens ordinaires, couvrant leurs actions avec la volonté divine.

Il est arrivé au point qu'en Europe, ils ont commencé à retirer lentement l'Écriture Sainte des mains des gens ordinaires, les privant de la possibilité de vérifier si les prêtres et les dirigeants disent la vérité.
Pour ces raisons, au Moyen Âge, la théodicée était souterraine. Parmi les quelques-uns qui, au moins d'une manière ou d'une autre, ont abordé ce sujet, nous pouvons citer le légendaire chef d'église et philosophe Augustin Aurelius (le bienheureux Augustin).
Dans ses écrits, il a adhéré à l'idée que Dieu n'a aucune culpabilité pour le mal existant dans le monde, car c'est une conséquence du péché humain. Soit dit en passant, une doctrine similaire est encore utilisée dans de nombreuses confessions chrétiennes.
Quels penseurs ont considéré ce sujet.
Au cours des siècles suivants (lorsque l'église a perdu son influence sur la société), il est devenu très à la mode de blasphémer sur les dogmes de la religion. Dans cette veine, beaucoup ont pensé à la théodicée. Il est devenu aussi populaire que l'écriture de traités religieux au Moyen Âge.

En réponse au travail de Leibniz, que Voltaire jugeait trop optimiste, cet auteur a écrit son propre roman philosophique "Candide" (1759). Dans ce document, il a parcouru de manière assez caustique de nombreuses réalités modernes et a exprimé l'idée de l'absence de sens de la souffrance. Niant ainsi l'idée théodicée que Dieu permet le mal au nom d'un but spécifique.
P. A. Golbach a pu critiquer plus systématiquement toutes les idées de Leibniz. Il a suggéré qu'il n'y a pas de place pour la théodicée en philosophie. Cela a été fait dans le "Système de la Nature" (1770).
Parmi les autres individus à l'esprit critique figurent F. M. Dostoevsky. Dans son roman Les Frères Karamazov, il exprime un déni de la dissolution du tourment ou de la culpabilité d'une personne en harmonie avec le monde entier.
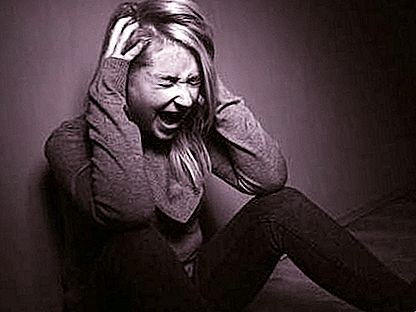
En plus de Dostoevsky, L.N. Tolstoï dans l'ouvrage «Pilier et déclaration de vérité».