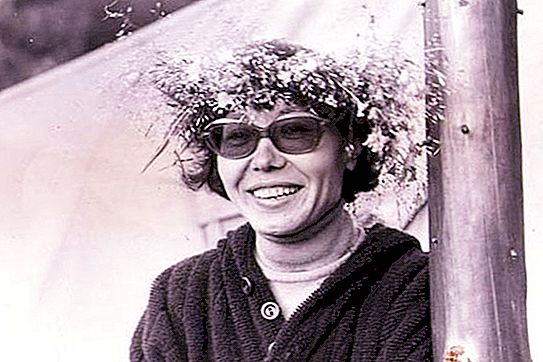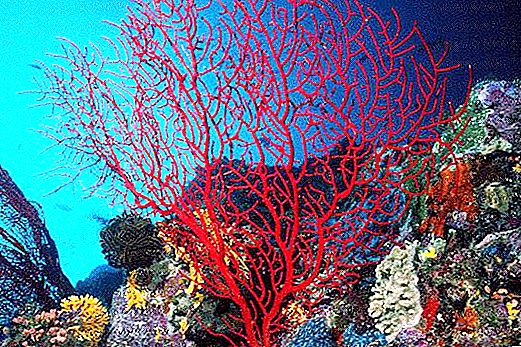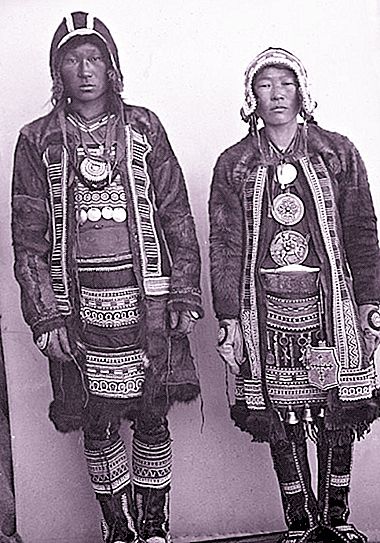Beaucoup de sciences sont engagées dans la vie et le monde intérieur des gens, mais seule la philosophie discute du but, de la place et de l'essence dans le monde. On peut dire que le problème de l'homme en philosophie est l'une de ses principales questions. Depuis les temps anciens, il existe de nombreuses définitions de l'appartenance à la race humaine. Même dans l'ère ancienne, ils parlaient en plaisantant d'une «créature à deux pattes sans plumes», tandis qu'Aristote parlait de façon très précise et succincte - une personne est un politikon zoon, c'est-à-dire un animal rationnel qui ne peut pas vivre sans communication sociale. À la Renaissance, Pico della Mirandola dans son «discours sur l'essence de l'homme» a déclaré qu'il n'y a pas de place définie pour les gens dans le monde et pas de frontières claires - ils peuvent s'élever au-dessus des anges dans leur grandeur et tomber en dessous des démons dans leurs vices. Enfin, le philosophe existentialiste français Sartre a appelé l'homme "une existence qui précède l'essence", ce qui signifie que les gens naissent en tant qu'être biologique, puis deviennent rationnels.
L'homme en philosophie apparaît comme un phénomène aux traits spécifiques. L'homme est une sorte de "projet", il se crée. Par conséquent, il est capable non seulement de créativité, mais aussi de «création de soi», c'est-à-dire de changement de soi, ainsi que de connaissance de soi. Cependant, la vie et l'activité humaines sont déterminées et limitées par le temps qui, comme une épée de Damoclès, est suspendu au-dessus. L'homme crée non seulement lui-même, mais aussi une "seconde nature", la culture, de cette façon, comme le dit Heidegger, "doublant l'être". De plus, selon le même philosophe, il est «un être qui pense à ce qu'est l'être». Et enfin, un homme impose ses mensurations au monde entier qui l'entoure. Protagoras a également déclaré que l'homme est la mesure de toutes les choses dans l'univers, et les philosophes de Parménide à Hegel ont essayé d'identifier l'être et la pensée.
Le problème de l'homme en philosophie se posait également en termes de relation entre le microcosme - c'est-à-dire le monde intérieur de l'homme et le macrocosme - du monde environnant. Dans l'ancienne philosophie indienne, chinoise ancienne et grecque ancienne, l'homme était compris comme faisant partie du Cosmos, un seul «ordre» intemporel, la nature. Cependant, des pré-socratiques déjà anciens, tels que Diogène d'Apollonie, Héraclite et Anaximène, avaient également une opinion différente, le soi-disant "parallélisme" du micro et du macrocosme, considérant l'homme comme un reflet ou un symbole du macrocosme. À partir de ce postulat, une anthropologie naturaliste a commencé à se développer, dissolvant l'homme dans l'espace (l'homme n'est composé que d'éléments et d'éléments).
Le problème de l'homme dans la philosophie et les tentatives de le résoudre ont également conduit au fait que le cosmos et la nature ont commencé à être compris anthropomorphiquement, comme un organisme vivant et spiritualisé. Cette idée s'exprime dans les mythologies cosmogoniques les plus anciennes du «pré-homme universel» (Purusha dans les Vedas indiens, Ymir dans l'Edda scandinave, Pan Gu dans la philosophie chinoise, Adam Kadmon dans la Kabbale juive). La nature a émergé du corps de cette personne, qui avait aussi une «âme cosmique» (Héraclite, Anaximandre, Platon, les stoïciens étaient d'accord avec cela), et cette nature est souvent identifiée à une certaine divinité immanente. La cognition du monde de ce point de vue agit souvent comme une connaissance de soi. Les néoplatoniciens ont dissous le Cosmos dans l'âme et l'esprit.
Ainsi, la présence d'un corps et d'une âme dans une personne (ou, plus précisément, un corps, une âme et un esprit) a généré une autre contradiction, qui caractérise le problème de l'homme en philosophie. Selon un point de vue, l'âme et le corps sont deux types différents de la même essence (les disciples d'Aristote), et selon l'autre, ce sont deux réalités différentes (les disciples de Platon). Dans la doctrine de la transmigration des âmes (caractéristique de la philosophie indienne, chinoise, partiellement égyptienne et grecque), les frontières entre les êtres vivants sont très mobiles, mais ce n'est que la nature humaine de lutter pour la "libération" du joug de la roue de l'existence.
Le problème de l'homme dans l'histoire de la philosophie était considéré de manière ambiguë. L'ancien Vedanta indien appelle l'essence de l'homme l'atman, dans son contenu interne identique au principe divin - brahman. Pour Aristote, l'homme est une créature avec une âme rationnelle et une capacité de vie sociale. La philosophie chrétienne a fait avancer l'homme dans un lieu spécial - étant «l'image et la ressemblance de Dieu», il est en même temps bifurqué par la chute. À la Renaissance, l'autonomie de l'homme était pathétiquement proclamée. Le rationalisme européen du Nouvel Âge a fait de l'expression de Descartes un slogan selon lequel la pensée est un signe d'existence. Les penseurs du XVIIIe siècle - Lametry, Franklin - ont identifié la conscience humaine avec un mécanisme ou avec un «animal qui crée les moyens de production». La philosophie classique allemande a compris l'homme comme un tout vivant (en particulier, Hegel a dit que l'homme est une étape dans le développement de l'idée absolue), et le marxisme essaie de combiner le naturel et le social en l'homme à l'aide du matérialisme dialectique. Cependant, la philosophie du XXe siècle est dominée par le personnalisme, qui ne se concentre pas sur «l'essence» de l'homme, mais sur son unicité, son unicité et son individualité.