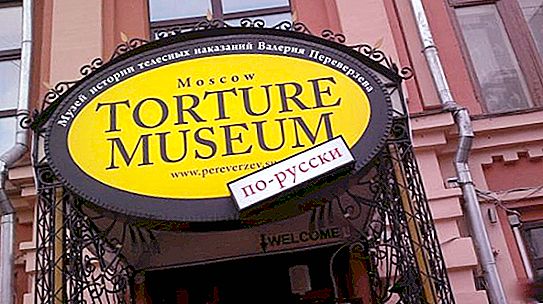La curiosité de ce qui nous entoure, les tentatives de comprendre comment fonctionne l'univers, ainsi que le désir de pénétrer le monde inconnu de l'autre monde, ont toujours été un signe de l'esprit humain. Lorsque les gens ressentent, expérimentent ou observent quelque chose qui arrive aux autres, ils l'assimilent et le consolident, voulant non seulement comprendre correctement la situation actuelle, mais aussi s'il est possible de comprendre la vérité. La cognition en philosophie est l'une des questions les plus intéressantes, car la philosophie essaie de rationaliser et d'expliquer les divers processus qui se produisent dans le cerveau humain et visent à obtenir des connaissances.
Le processus de cognition est plus compliqué que la simple accumulation de connaissances - il est créatif, culturel et social; Elle implique non seulement des mécanismes de pensée rationnels, mais intuitifs et sensoriels. C'est pourquoi la cognition en philosophie est un problème spécial, qui traite d'une section théorique spéciale appelée épistémologie ou épistémologie. Le début de l'épistémologie en tant que branche spéciale de la philosophie a été posé par le Scot Ferrier au 19ème siècle. Cette discipline philosophique étudie à la fois les méthodes et les principes d'obtention de connaissances, ainsi que ce qu'est la cognition, ce qu'elle a à voir avec le monde réel, si elle a des frontières, et aussi quelles sont les relations entre ce qui est connu et ceux qui le savent. Il existe de nombreuses théories différentes de la connaissance qui se critiquent mutuellement et offrent de nombreux concepts sur ce que la connaissance est vraie et fiable, quels sont ses types et pourquoi nous sommes généralement capables de connaître le monde et nous-mêmes.
En bref, les philosophes du domaine cherchent à comprendre pourquoi les connaissances existent; comment pouvons-nous déterminer que ce sont précisément des connaissances qui ont la certitude et la vérité, et non un jugement (ou une opinion) superficiel, ou même une illusion; comment ces connaissances se développent, et quelles sont les méthodes de cognition elles-mêmes. En philosophie, tout au long de son histoire, la question a été extrêmement aiguë du sens de l’acquisition des connaissances pour l’homme et l’humanité, qu’elles apportent bonheur ou tristesse. Quoi qu'il en soit, dans la vie de la société moderne, l'acquisition de nouvelles connaissances a acquis une telle importance que le stade actuel de développement de cette société est souvent appelé celui de l'information, d'autant plus que c'est l'espace informationnel qui a uni l'humanité.
La cognition en philosophie ressemble à un processus qui a une nature sociale et de valeur. L'histoire nous apprend que les gens sont prêts non seulement à acquérir de nouvelles connaissances, mais aussi à les maintenir, en dépit du fait que très souvent ils ont dû et doivent payer de leur vie, la liberté, la séparation de leurs proches. Puisqu'il s'agit d'un processus, il est similaire à d'autres types d'activités étudiées en philosophie et, comme eux, est déterminé par les besoins (désir de comprendre, d'expliquer), les motifs (pratiques ou purement intellectuels), les objectifs (acquérir des connaissances, la compréhension de la vérité), les moyens (comme l'observation, l'analyse, l'expérience, la logique, l'intuition, etc.) et les résultats.
L'un des principaux problèmes auxquels la pensée philosophique s'intéresse est de savoir comment se développe la cognition. La philosophie a initialement établi que le premier type de connaissances était naïf, les connaissances ordinaires, qui au fil du temps, dans le processus de développement de la culture, se sont améliorées, donnant lieu à l'émergence de principes théoriques de la connaissance et de la pensée scientifiques. Dans le même temps, la philosophie fait la distinction entre les principes et méthodes de la connaissance philosophique proprement dite et l'étude de connaissances scientifiques spécifiques (philosophie des sciences).
Les philosophes ont également réfléchi au rôle joué par le sujet cognitif dans le processus de cognition. La cognition en philosophie n'est pas seulement l'étude des choses et des processus entourant une personne ou se produisant en elle indépendamment, mais aussi sa vie spirituelle. Sachant, une personne se rend compte non seulement qu'elle étudie quelque chose d'extérieur, mais aussi que cette étude affecte elle-même. De plus, notamment dans le domaine de la cognition humanitaire, l'état du sujet connaissant, ses valeurs et ses convictions peuvent influencer les résultats de la cognition. En évaluant ce problème complexe, les philosophes de différentes directions sont arrivés à des conclusions complètement opposées. Par exemple, les positivistes ont reproché à la connaissance humanitaire le manque d'objectivité, et les représentants de l'herméneutique philosophique, au contraire, ont considéré la subjectivité comme une caractéristique spécifique de la connaissance humanitaire, qui, par conséquent, est plus proche de l'immédiateté, et donc de la vérité.